27/03/2015
Note : la philosophie reflexive
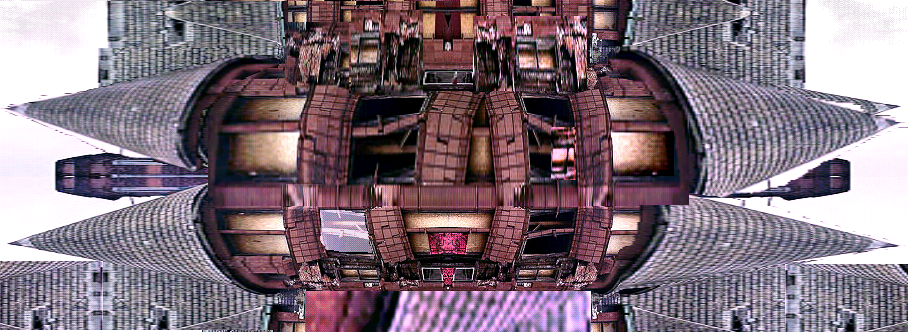
« Ce n'est donc point dans les impressions que réside la science, mais dans le raisonnement sur les impressions ; car c'est par cette voie, semble-t-il, qu'on peut atteindre l'essence et la vérité, tandis qu'on ne le peut par l'autre. » Socrate, Théétète [186b ; 186d]
« Il est donc vrai, que dans tous les domaines où l’esprit se révèle comme créateur, la réflexion est appelée à retrouver les actes que dissimulent et que recouvrent les œuvres, dès que, vivant de leur vie propre, elles sont comme détachées des opérations qui les ont produites. Il s’agit pour elles, de mettre au jour le rapport intime de l’acte et des significations dans lesquelles il s’objective. Loin d’ignorer que l’esprit, dans tous les ordres doit d’abord, œuvrer, se produire dans l’histoire et dans une expérience effective pour saisir ses possibilités les plus profondes, l’analyse réflexive révèle toute sa fécondité en surprenant le moment où l’acte spirituel s’investit dans le signe qui risque aussitôt de se retourner contre lui. » J. Nabert, encyclopédie française
La difficulté qui « concerne les rapports de l’acte par lequel une conscience se pose et se produit avec les signes dans lesquels celle-ci se représente le sens de son action, n’est pas propre à la pensée de Nabert ; il est commun à toutes les philosophies qui tentent de subordonner l’objectivité de l’Idée, de la Représentation, de l’Entendement, ou comme on voudra dire, à l’acte fondateur de la conscience qu’on appelle Volonté, Appétition, Action. Quand Spinoza remonte de l’idée à l’effort de chaque être pour exister, quand Leibniz articule la perception à l’appétition, et Schopenhauer la représentation à la volonté, quand Nietzsche subordonne perspective et valeur à la volonté de puissance, et Freud la représentation à la libido – tous ces penseurs prennent une décision importante concernant le destin de la représentation : elle n’est plus la fonction primaire, le fait premier le mieux connu, ni pour la conscience psychologique, ni pour la réflexion philosophique. Elle devient une fonction seconde de l’effort et du désir ; elle n’est plus ce qui fait comprendre mais ce qu’il faut comprendre. » Paul Ricoeur
09:18 | Lien permanent | Commentaires (0)
Note
"L’office de la réflexion, c’est de ne pas laisser en dehors l’une de l’autre, l’intimité de la conscience et l’universalité de la raison." Jean Nabert, l'expérience intérieure de la liberté.
01:56 | Lien permanent | Commentaires (0)
26/03/2015
Note
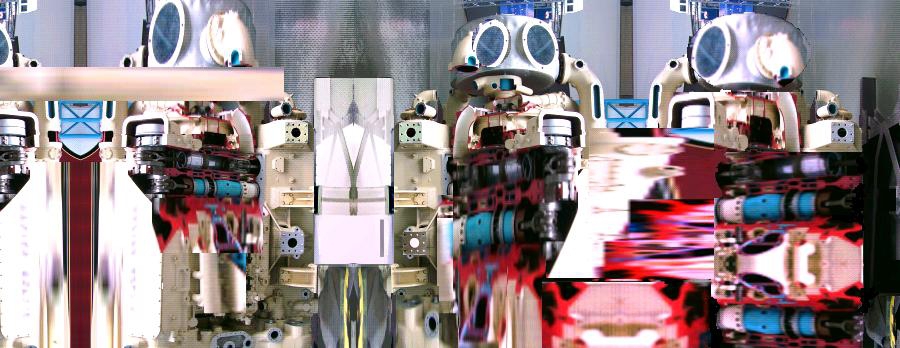
La poursuite du résultat refoule la recherche de la vérité. Le résultat est la somme apeurée des digressions nécessaires aux occasions propres a une intentionnalité de s'examiner (de visiter sa propre intention éternelle en chaque point du temps) qui poursuit le somnambule égaré au lieu de le conduire comme si l'examen par le résultat devait établir non pas que l'intention infinie est bonne, mais que le résultat l'est infiniment, ce qui dés lors dévalorise l'intention, lui ôte toute réalité, tend a confondre l'infini téléologie et l'angoisse déstructurée, et immobilise l'existant dans son cauchemars d'angoisse cristallisée; la recherche de la vérité offre a l'existence autant qu'aux facultés et a la société, la dialyse du cycle des interrogations légitimes qui vertèbre et articule par une histoire, la présence téléologique de l'homme auprès du sens transcendant; la poursuite du résultat comme fin en soi capitalise certes toutes les énergies, mais leur dénie un sens qui serait une fin en soi; la poursuite du résultat est par essence a-spirituelle et est en soi dénuée de sens, c'est a dire entièrement culpabilisante puisqu'elle vise a supprimer l'intention ontopoétique qui collabore a sa création et au dépassement des résultats qui ne sont que des occasions pour l'esprit d'examiner son intentionnalité en devenir conscient.
11:35 | Lien permanent | Commentaires (0)